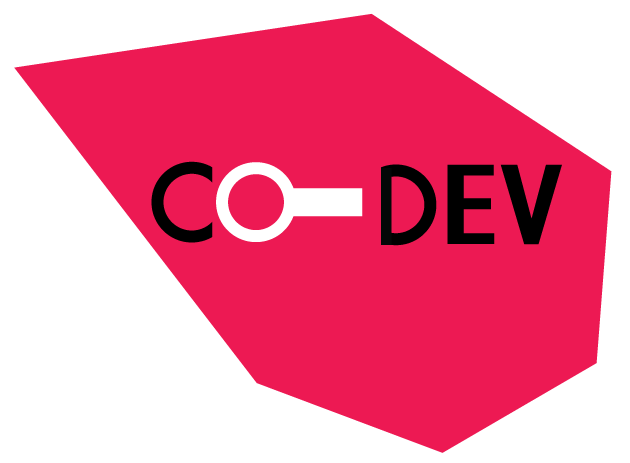Deux ou trois phrases, parfois une photo. La vigueur restaurée par une demi-heure de jardinage, la
jubilation d’une balade en pédalo avec les enfants, la saveur subversive d’une soirée lecture sans
écran, l’émulation d’une réunion militante, l’inattendu d’une virée solo en train pour visiter une
expo, l’audace de se lancer dans un truc nouveau, les perspectives d’avenir ouvertes par l’avancée
des travaux, la beauté d’un film, d’un concert, une marque de reconnaissance reçue pour quelque
chose que l’une ou l’autre a fait… Avec Marion, entre deux rencontres plus ou moins régulières, on
s’envoie des joies comme des cartes postales. Rien de systématique. C’est venu comme ça. À force
de constater à quel point ça manquait et à quel point ça nous faisait du bien de recevoir et donner
des joies. Ça n’empêche pas de partager aussi les indignations, les soucis et les galères. Mais ça
nous donne de l’oxygène pour faire et créer, dans un monde où les tyrans veillent à cultiver nos
passions tristes pour reprendre l’expression de Maurice Merleau-Ponty.
Et puis le réel, c’est aussi ça : une série chaotique de grâces
auxquelles il nous revient de faire une
place envers et contre notre tendance à nous focaliser sur le pire. Envers et contre les écrasantes
idéologies. On l’apprend au code de la route… Si vous passez votre temps à observer le fossé, vous
finirez par le voir de trop près. Savoir son existence doit nous encourager à regarder attentivement
ailleurs, à savoir devant soi, la route qu’on veut prendre et son horizon.
Ce que je vous raconte là, l’importance du partage des joies pour notre santé mentale et physique,
ce n’est pas qu’une affaire d’amitié. C’est aussi social et politique. Et d’ailleurs l’amitié, notamment
comme soin mis à s’envoyer de l’oxygène quand les temps sont durs, c’est aussi voire d’abord
social et politique.
Sur un Slack partagé par des développeur·euses – un Slack professionnel donc, que j’ai rejoint il y a
quelques années, bien qu’étant philosophe ! – il y a un canal #joies. C’est l’un des rares que je
consulte régulièrement. Bien que ne se connaissant pas tous·tes personnellement, nous y déposons
parfois des mini cartes postales, et avons du plaisir à lire les autres. « On a assez peu d’endroits où
on encourage le partage des joies », note l’un d’eux. On y ressent « la joie que procure la joie
d’autrui », relève quelqu’un d’autre. « C’est beau de reconnaître une joie même légère », et à
plusieurs, ça produit une « collection collective hétéroclite », poursuit un autre contributeur régulier
sur ce canal, canal qui offre une garantie de « good vibes », résume encore le modérateur de ce
même Slack. Ces good vibes font du bien. Mais elles vont à l’encontre de nos pratiques sociales
qui associent confusément intelligence et mépris, notamment mépris de tout ce qui peut ressembler
à une manifestation de joie.
Les réunions comme des vinaigrettes peuvent piquer trop ou trop peu
Toute forme de réunion est une fabrique à émotions. Et l’état dont vous sortez d’une réunion est aussi variable que le goût laissé par une vinaigrette. Comme disait l’un de mes sensei à l’université, c’est très difficile de faire une bonne vinaigrette, mais ça vaut le coup (qu’il ait aimé ma vinaigrette ce jour où nous fêtions son départ à la retraite fut l’une de mes plus grandes fiertés académiques !). Si vous n’y prêtez pas attention, le mélange risque d’être très piquant. Et source de souffrances professionnelles. Certain·es (et surtout certaines) se forceront à sourire la bouche en feu pour rendre le moment collectivement supportable et sauvegarder l’ambiance en faisant parler les autres, en s’intéressant à ceux qui, eux, bougonneront ouvertement. Les réunions – en famille comme au travail - sont souvent comme des pièces de théâtre où chacun·e rejoue très vite son rôle devenu habituel et souvent indissociable des caractéristiques attendues selon son genre et sa position sociale. Cette « mise en scène de la vie quotidienne » pour reprendre le titre du livre d’Erving Goffman, c’est un peu le template par défaut de nos réunions où, comme l’a montré le sociologue, la stigmatisation et le mépris opèrent comme le mode normal de communication des classes dominantes. Dans une société patriarcale qui valorise l’autorité bougonne et délègue la jovialité aux femmes (la joie, c’est du care), mettre les joies à l’ordre du jour collectif, c’est en quelque sorte corriger un peu le template initial et dysfonctionnel de la réunion / vinaigrette. Ce template qui fait du dîner de Noël une épreuve souvent redoutée !
Avec quelques précautions culinaires, quelques dosages bien sentis, une bonne salade et un bon
timing, et malgré tout une petite touche de fantaisie créative, une réunion peut fournir des apports
équilibrés en connaissance de soi, des autres, du réel commun et en oxygène pour soutenir chacun·e
dans les projets en cours.
En d’autres termes, j’aimerais avancer cette hypothèse : si vous encouragez les personnes à partager
leurs joies dans une réunion - et si vous assurez qu’elles seront écoutées attentivement, vous pouvez
modifier la vinaigrette de base que nous redoutons tous·tes. Et ça pourrait éviter que la joie elle-même
ne soit imposée à quelques uns, surtout quelques unes, comme l’objet d’un « travail
émotionnel » pour reprendre l’expression et la théorie d’Arlie Hochschild.
En finir avec la joie comme « travail émotionnel » des femmes
Dans son livre The Managed Heart, la sociologue Arlie Hochschild appréhende les émotions comme des composantes du travail lui-même, et ces composantes sont genrées. Alors qu’on s’intéresse ordinairement aux effets émotionnels d’un travail qu’on continue de regarder comme l’exécution d’une tâche rationnelle, la sociologue analyse la façon dont les émotions peuvent constituer le travail lui-même. De sorte que la distribution des professions soit aussi et d’abord une distribution normative des sentiments. Travailler en ce sens, c’est s’efforcer d’avoir les sentiments qu’on attend de nous, de se conformer le plus possible aux gestes affectifs qui forment le travail prescrit. Un travail émotionnel donc. À titre d’exemple emblématique, elle analyse le détachement que les hôtesses de l’air doivent développer à l’égard de leur propre sensibilité, afin de pouvoir afficher l’attitude parfaitement souriante, enthousiaste et prévenante qui est attendue d’elles. Ce qui vaut pour tous les rôles considérés comme « féminins », donc dociles. À l’inverse, autre exemple qu’Hochschild étudie, les recouvreurs d’impôts doivent adopter un ton désagréable et une mine colérique de façon à susciter de la crainte. Caractéristiques émotionnelles attendues des rôles considérés comme masculins, donc autoritaires. Notez que dans les deux cas, le travail est un travail émotionnel et a des effets délétères sur les personnes. Ce n’est pas drôle non plus de devoir être bougon pour afficher une forme de bonhommie respectable. Mais cette empreinte genrée de nos sensibilités est marquée par un traitement social différentiel et stigmatisant. Dans les sociétés patriarcales, il n’y a rien de pire qu’un travail qui effémine comme l’ont montré des sociologues comme Blake E. Ashforth et Glen E. Kreiner, ou encore les travaux passés et en cours de Caroline Ibos. Et exprimer une joie peut être vu comme un geste efféminant, comme tous les gestes vitaux.
Il y a toutes sortes de recettes de vinaigrette, et l’on peut expérimenter différents arrangements en cuisine comme en salle de réunion. Pour Spinoza, la joie (un affect fondamental qui n’était pas contraire à la virilité !) tient dans le sentiment que nous avons de notre puissance d’agir. Et de même que la connaissance des ingrédients et de leurs réactions permet d’améliorer les saveurs de la sauce, la connaissance de nos affects doit nous aider à augmenter notre puissance d’agir. Non par le déni de la tristesse (sentiment que nous avons de notre impuissance) et de la crainte, mais par la compréhension de ce qui renforce notre vitalité (le conatus dit Spinoza), notre capacité à les surmonter par le désir et l’action.
On dirait aujourd’hui que la conscience de ma joie – et de celle des autres dans un contexte collectif – est empouvoirante au sens où elle renforce ma capacité d’agir (et non de dominer qui est plutôt l’affaire du ressentiment, son contraire). Voilà pourquoi les chefs aiment renforcer la peur et la tristesse (sans réellement écouter les plaintes bien sûr). Et pourquoi il faudrait au contraire cultiver les joies dans nos espaces de réunion quels qu’ils soient (jusque dans nos réunions intérieures avec toutes ces voix qui nous habitent !). Parce que le contraire de la violence - envers nous comme envers les autres - est sans doute là : encourager collectivement nos joies individuelles.
Suite dans un prochain billet !