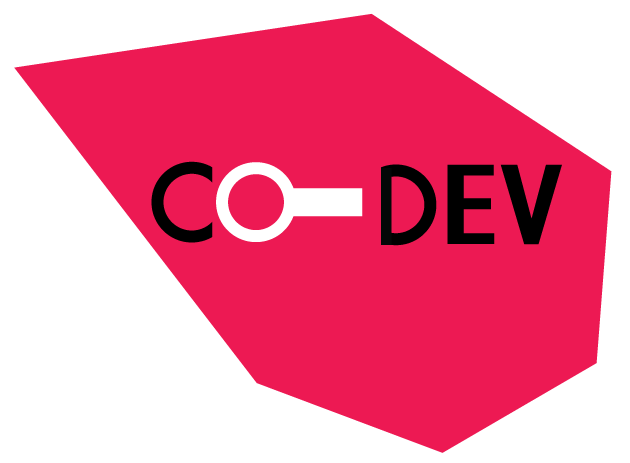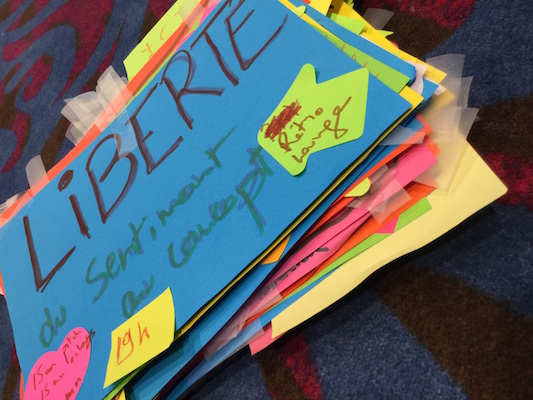« Je veux pas rentrer. » Une inspiration.
On est tous là assis en rond, et le soleil encercle par la vitre le bout d’un cycle qui s’achève. Ambiance apaisée, joie enfiévrée de la tâche accomplie. Un peu la crainte aussi du plus-rien-à-faire — la peur du vide, là tapie dans l’ombre, qui déjà rampe.
Quentin s’est levé, il déchire le silence. « Je veux pas rentrer », qu’il répète. Une inspiration plus longue encore. « Je veux pas que ça finisse », conclut-il d’une voix plus basse, résigné qu’il est déjà pourtant.
Et tu te dis : c’est ça, c’est bien ça. Je veux pas rentrer, qu’il a dit, et tu entends : je veux pas mourir. Et tu réalises que c’est ça la vie : ce que tu as vécu pendant trois jours. Qu’il n’y a pas de mot pour ça, juste un contraste immense, une majuscule différence avec le quotidien.
Et tu sens l’amour, la peur, la nostalgie qui déferlent en toi. Une vraie tempête. Un trop-plein d’émotion que tu t’acharnes à contenir avec la même énergie du gamin que t’as été, qui d’une paille blanche et rouge aspirait l’Orangina jusqu’à la dernière goutte à grand bruit, grand fracas — comme pour retenir un instant encore la joie d’une après-midi ensoleillée, échouée sur la terrasse d’un café, trouvée par un hasard presque pas mérité, pensais-tu, et que tu n’allais malgré tout pas lâcher comme ça. Finder’s keeper.
Alors tu te demandes si ce n’est pas ça, mourir : aspirer à travers une paille trop grosse les dernières gouttes de soda au fond du verre. Telle une cellule dans un corps complexe, tu sens intensément cette énergie qui se dissipe, tu ressens cette douloureuse impression de désintégration, cette abdication collective à former un conteneur, à nourrir les envies individuelles pourtant puissantes encore — cicatrices des liens qui ont pu se tisser, empreintes-mémoires des attractions fortes qui ont pu s’exercer. Et de tes doigts gourds du souvenir, tu retiens encore ce que tu peux mais tu sais bien qu’au fond ça va finir, que c’est déjà en train de finir, que c’est ridicule de s’accrocher à un encore-en-cours sur une page déjà tournée.
Alors tu lâches tout et le film défile à toute allure devant tes yeux.
Tu repenses à tout ce qui a valu la peine d’être vécu, à ce privilège improbable, immense, inouï, d’avoir fait partie de quelque chose de plus grand que ton mètre soixante-huit. Et tu croises les regards des autres assis avec toi dans le cercle, croisement forcément embué de larmes incontinentes, et tu décides que non ce n’est pas une illusion, que cette énergie que tu sens, là, qui s’en va, qu’on a invoquée, retenue, fait enfler au point de s’envoler, accrochés à elle, à des altitudes inattendues — tu décides précisément à cet instant que cette énergie-là te dépasse et ne t’appartient pas. Qu’elle s’est juste invitée là. Alors finalement, peut-être que c’est ça la mort, plus justement, que tu te dis : la célébration de ce miracle improbable qu’un quantum d’énergie vitale ait accepté de ce poser au creux d’un tissu pour l’animer un instant, avant de repartir – goodbye, farewell – en animer un autre, ailleurs.
Et curieusement, savoir que tout ça n’est pas fini, juste l’envol d’un papillon du creux des mains métaphoriquement ouvertes, papillon qui ira se poser ailleurs illuminer les regards d’un autre groupe, curieusement savoir tout ça t’apaise.
Les larmes continuent de couler à torrents mais tu n’es plus triste. Tu te dis juste que l’Alsace trois jours par an, c’est tellement trop peu que ç’en est vraiment trop con.