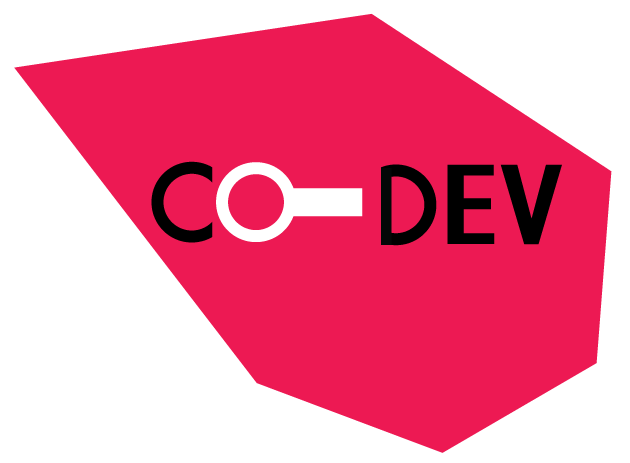Rétrospectivement, on s’étonne de l’absurdité. On aurait pu prendre telle ou telle décision tranquillement, plus tôt, dans de meilleures conditions, au lieu de tergiverser, laisser en suspens, différer un choix qu’on ne tranchera qu’une fois arrivée l’ultime échéance temporelle. C’eût été plus rationnel, moins stressant, et il n’y a pas de corrélation logique entre la longueur de la réflexion et la meilleure décision, à informations égales bien sûr. On sait qu’il nous est arrivé de faire des choix qu’on qualifiera de mauvais, par excès – et non par manque – de temps de réflexion. On pourra se sentir un brin vexé·e d’avoir manqué de rationalité et se condamner d’avoir commis encore une fois ce péché à la fois ressassé et diabolisé par notre culture productiviste : la procrastination.
Il est vrai qu’on peut distinguer une réaction immédiate d’une action choisie par leur temporalité différente. Mais en creusant, si l’on admet que nous sommes des êtres bien moins rationnels qu’on aime le croire (un simple coup d’œil dans le rétroviseur de l’histoire et sur le théâtre du monde nous renseigne pas mal), on peut interpréter la prise de décision autrement : ce qui fait la décision, ce n’est pas la supériorité rationnelle du meilleur argument dans un calcul abstrait et neutre. Ce qui fait une décision, c’est sa position temporelle dans la délibération : une décision est le dernier moment d’une délibération, le moment d’arrêt imposé par un arbitraire externe ou interne qui nous contraint à l’action.
En d’autres termes, décider au dernier moment – au moment qui précède immédiatement l’action et/ou coïncide avec elle – n’est peut-être pas un trouble procrastinatoire. Ce serait plutôt une tautologie. Pourquoi ?
La décision est une passion comme une autre…
Une conception trop méconnue de la décision a été proposée avec une grande clarté par le philosophe empiriste Thomas Hobbes (1588 - 1679). Dans son essai De la nature humaine, Hobbes soutient que la délibération n’est pas la mise en balance d’arguments et contre-arguments rationnels au sujet d’une action envisagée, mais la succession dans le temps de désirs et de craintes, nos deux affects fondamentaux. Nourris par des croyances tirées d’expériences antérieures, les désirs comme les craintes alternent en nous jusqu’à ce que la délibération s’arrête sur l’un ou sur l’autre.
Par exemple, lorsqu’on hésite à envoyer un e-mail délicat et non formellement nécessaire, on se représente le soulagement qu’on éprouvera à communiquer notre message, puis la crainte que l’autre ne se braque, puis l’espoir que la situation problématique ne se représente plus, puis la peur de ne pas être compris·e etc. Au moment de cliquer, la délibération qui l’aura précédé consiste dans une suite de désirs (représentations du plaisir que j’éprouverais, selon mes croyances) et de craintes (représentations de douleurs auxquelles l’action envisagée m’exposerait, selon mes croyances). Ma décision d’envoyer n’est que le dernier temps de la délibération. Mais retirons quelques secondes à la délibération parce que je suis interrompu·e par un coup de fil ou l’alarme de mon détecteur de fumée, et la décision aurait été mon renoncement.
Ce qu’on prend pour un temps de réflexion ne confronte pas des arguments simultanés, mais consiste dans des passions successives, « ces désirs et ces craintes qui se succèdent les uns aux autres aussi longtemps qu’il est en notre pouvoir de faire ou de ne pas faire l’action. »
De sorte que la décision n’est pas une opération rationnelle pour Hobbes (la raison ne peut pas nous faire agir), mais ce qu’on appelle au XVIIe siècle une passion, à savoir le dernier désir ou la dernière crainte sur lequel / laquelle la délibération s’arrête.
Que faire de cette lucidité ?
Qu’apporte cette manière de comprendre la décision à travers le prisme de nos émotions et de la dimension temporelle de leur enchaînement dans la délibération ? Elle est utile sous trois angles au moins.
1/ D’abord, cette vision rend compte de l’intérêt de prendre les devants et de fixer d’emblée un temps limité à nos processus de prises de décision. En prenant acte du caractère arbitraire de la temporalité de la décision (le dernier « argument » qui l’emporterait n’est pas le meilleur, il est simplement le dernier), on peut l’organiser d’une façon qui soit plus sereine. À force d’étirer le plus possible les temps des délibérations en cours, on accroît une charge mentale qui mobilise notre mémoire, notre attention et entrave notre capacité à sonder clairement les aspirations et les craintes en jeu. Au contraire, on pourrait faire en sorte qu’une délibération puisse commencer par l’acte de lui projeter un terme, terme qui soit approprié à nos autres contraintes de calendrier et à notre envie de libérer notre attention pour d’autres sujets ou décisions. Ou pour être tranquilles plus vite.
2/ Ensuite, on pourrait y voir une raison de plus de… ne pas chercher à avoir raison ! Mais chercher plutôt à sonder avec le plus d’acuité possible les émotions qui se nichent dans ce qu’on croit être nos arguments rationnels. Combien d’initiatives sont empêchées parce qu’une personne annonce avec aplomb un argument, qui n’est que la projection rhétorique d’une peur bien plus profonde et déniée comme telle ? Les peurs étant souvent plus contagieuses que les désirs, avoir conscience de la nature émotionnelle de la décision nous rend plus proactifs ou résistant·es. Le temps de la délibération est alors un temps où l’on se concentre pour identifier les émotions, où l’on peut développer son esprit critique pour affiner nos croyances et repérer les tabous, et finalement tenter de trancher en faveur d’une aspiration qui importe plus qu’une peur, non parce qu’elle est plus rationnelle, mais parce qu’elle nous meut davantage.
3/ Enfin, et contrairement à ce qu’on pourrait croire de prime abord, cette approche de la décision permet aussi de lui redonner une épaisseur éthique. Pour Hobbes (mais il n’est pas le seul à l’affirmer), nos inclinations actuelles – et les croyances qu’elles véhiculent – sont liées à nos expériences répétées dans le passé. Donc la décision que nous prenons est un désir renforcé par les habitudes que nous avons prises et se trouve nécessairement liée à notre tempérament. On peut bien sûr faire prendre des plis différents à nos inclinations et peurs au fur et à mesure de nos actions. Mais il n’en demeure pas moins que si l’on veut prendre des décisions moralement justes ou bonnes, cela s’inscrit dans le temps long du caractère et de l’attention répétée à ce que nous nous représentons comme désirable.
Cela me fait penser au travail décisif (si je puis dire !) de Martha Nussbaum sur les émotions démocratiques. Elle met en avant que les valeurs démocratiques (ou leur destitution) commencent d’abord en nous : dans notre capacité à développer de l’empathie pour les autres, notamment pour les personnes minorisées, ou au contraire à nous laisser submerger par notre propre angoisse de vulnérabilité et la privation d’empathie qui en résulte. Dans ce cadre, une décision juste – quel que soit l’instant où je l’ai prise – incarne ma capacité à identifier mes peurs de façon critique et à avoir l’attention ainsi tournée vers mes aspirations éthiques et démocratiques.
Cet article est une première version d’un billet finalement publié sur Simone et les philosophes