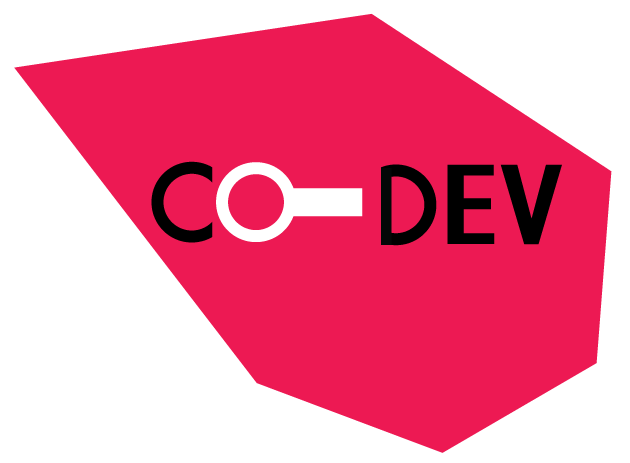Quand tu écris, tu écris pour des gens. Dans les manuels de savoir-écrire, on t’explique : pour que ça marche, il faut que tu aies en tête la personne à qui tu t’adresses, que tu la visualises, qu’elle prenne corps dans ton texte, comme lecteur ou lectrice idéale. Reste que, des fois, c’est dur. Tu dois écrire une proposition commerciale, une lettre de réclamation ou toute autre joyeuseté parmi celles qu’on range sous la bannière du Saint Courrier Administratif. Quand tu te fends d’une lettre sur l’autel du SCA, c’est en général pour récupérer du pognon (ou, tout au moins, pour ne pas en perdre). Quelque part, ça te motive suffisamment pour le pondre, le fichu courrier. Mais tout de même, comme tu aimes écrire pour des gens plutôt que pour instruire un hypothétique règlement de compte judiciaire, ça te pèse malgré tout.
Et puis un jour, joie ultime, tu découvres le morceau de sucre qui aide la médecine à couler : tu écris ton courrier administratif en LaTeX. Tu t’inventes un jeu dont la règle est simple — ne pas passer plus de temps dans le LaTeX que tu n’en aurais passé avec ton logiciel de traitement de texte habituel. Au début, ça veut dire que tu auras des lettres assez moches avec beaucoup de duplication (ce qui, au final, n’est pas très différent de ce que tu obtiens ordinairement). La bonne nouvelle, c’est que le coup suivant, tu peux commencer à bosser les styles, à apprendre comment faire un truc plus proprement — jusqu’au moment où tu sens bien que LaTeX est un outil pour programmeurs et qu’il doit y avoir un moyen de gérer proprement la question de la duplication. Et là, tu découvres les macros, les environnements… en un mot comme en mille, le nouveau continent. Tu es le Christophe Colomb du courrier administrachiant, tu apprends un nouveau langage de programmation, tu modularises ta production textuelle comme tu le ferais sur ton code, et en plus au final, tu produis des documents d’une beauté à pleurer.
Quand on monte sa boîte pour pouvoir faire enfin son métier de programmeur comme on l’entend, on sent rapidement qu’il faut se colleter un paquet de tâches qui éloignent de la programmation. C’est déprimant : pour pouvoir programmer avec plus de bonheur, on se retrouve à juste moins programmer, ou à devoir payer quelqu’un pour gérer ces différentes tâches, dans l’espoir d’enfin pouvoir se concentrer sur ce qui importe. Inversement, il y a quelque chose de jouissif à contrer ces forces qui nous éloignent de notre métier. Un plaisir à inventer une forme d’aïkido, qu’on pourrait aussi voir comme une radicalisation de son travail professionnel. Car c’est bien de ça, dont il est question : maîtriser suffisamment une technique, une discipline, un art — pour pouvoir en vivre, c’est-à-dire l’embrasser comme mode de vie, sans prétention ni compromis.